La cause principale est le raccourcissement du sphincter urétral au cours de la prostatectomie. En outre, au retrait de la prostate, tous les nerfs qui l’entourent et le sphincter situé en dessous sont blessés. La problématique est très complexe. D’un point de vue anatomique, la disparition du bloc prostatique fait du sphincter urinaire le seul acteur de la continence, sans son support anatomique habituel.
Les facteurs de risque :
- L’âge : la densité des cellules musculaires fonctionnelles dans le sphincter décroit avec l’âge. Plus on opère un patient âgé, plus le patient est exposé aux risques de complication. Le mécanisme récupèrera moins bien.
- Le surpoids, l’obésité
- Les troubles existants en pré-opératoire
- Le volume prostatique
- La gravité du cancer. Si le cancer est étendu ou qu’il y a un début de franchissement capsulaire, le chirurgien est obligé d’opérer plus large. Les « dégâts » sont donc plus importants.
- L’expérience du chirurgien
- Les autres paramètres techniques (considérés comme mineurs)
A ce jour, aucune étude scientifique ne démontre un bénéfice supérieur quant à la continence entre la prostatectomie dite à ciel ouvert, par cœlioscopie ou par voie coelioscopique robot-assistée.
La radiothérapie après l’acte de chirurgie aggrave un peu le problème d’incontinence. La cicatrisation est très difficile à évaluer. La récidive peut également avoir un rôle car les tissus sont modifiés.
LES Différents TYPES D’INCONTINENCE
L’incontinence à l’effort
C’est celle à laquelle on s’intéresse après la prostatectomie et qui concerne le sphincter. Elle est provoquée par la toux, l’éternuement, la marche, le changement de position. Le sphincter est un muscle. Comme tout muscle sollicité en permanence, il se fatigue en fin de journée. Toute la problématique est de trouver comment faire en sorte qu’il ne se fatigue pas.
L’incontinence par impériosité
Cette forme d’incontinence est due à une contraction de la vessie. L’adénome (inflammation de la prostate) est la cause la plus fréquente de l’incontinence par instabilité vésicale chez l’homme : gouttes retardataires (car peu ou pas de pression), envies pressantes, on ne peut pas se retenir, on est obligé de courir pour se rendre aux toilettes. Le traitement est assez simple via le massage urétral.
L’incontinence peut être mixte et associer ces deux mécanismes cités. Les deux premiers types d’incontinence étant différents, les traitements associés le sont également.
évaluation
L’évaluation est très importante car l’incontinence est très différente d’un patient à l’autre en termes d’intensité, de perception et de retentissement. Chaque patient est unique.
Après une prostatectomie, les fuites surviennent le plus souvent à l’effort ; il importe d’abord d’éliminer une part d’incontinence par impériosités (contraction de la vessie provoquant des fuites sur urgences) : c’est le rôle du bilan urodynamique.
Les fuites sont parfois invalidantes. Elles peuvent être permanentes ou intermittentes et impliquent le port d’un nombre variable de protections. Les hommes qui viennent consulter sont souvent actifs (activités professionnelles ou loisirs). La qualité de vie peut être extrêmement affectée par ce trouble, et elle doit être évaluée, au mieux grâce à des questionnaires standardisés. Il est aussi indispensable de mesurer, en grammes, la quantité d’urines perdue en 24 heures (par ce que l’on appelle un Pad-Test, test qui consiste à peser les protections sur une journée).
Certains patients, et à juste titre, pensent avoir troqué « un petit cancer » contre une incontinence permanente. La consultation montre souvent que les patients ne connaissent pas les traitements existants.
L’autre problématique liée à la fonction sexuelle (autre effet secondaire classique de la prostatectomie) est la perception qu’à le conjoint du problème d’incontinence
première consultation
On essaie d’estimer :
- la part d’incontinence à l’effort et éventuellement la part d’incontinence par impériosité.
- l’importance de cette incontinence : le nombre de protections quotidien, évolutivité des symptômes, les thérapeutiques déjà mises en œuvre. Un patient qui est incontinent depuis 6 mois et n’a pas fait de rééducation, doit d’abord se rééduquer et attendre un délai d’un an après la chirurgie pour constater une évolution ou non. Un patient qui a fait 25 séances de rééducation et qui est à 5 ans de la prostatectomie, a peu de chances de voir une amélioration dans le temps s’il est incontinent. On ne traite pas ces deux types de patients de la même manière.
Il existe des échelles d’agressivité différentes pour adapter le traitement. Il est très important d’évaluer la qualité de vie et le retentissement de cette dysfonction chez le patient. Ces dérèglements de la qualité de vie peuvent se présenter sous de multiples aspects parfois très graves.
Dans les 6 mois après chirurgie
50 %
des patients auront une incontinence
Phase post-opératoire et récupération
Après l’opération
Les six premiers mois après l’opération correspondent à une période où le risque d’incontinence urinaire est très élevé. Probablement plus de la moitié des malades se trouvant dans le postopératoire précoce a un risque d’avoir une incontinence urinaire à des degrés divers. Cette période sera, fatalement, forcément difficile à vivre. Hormis la rééducation, on dira le plus souvent au patient d’attendre, parce que le temps, parfois, permet de récupérer cette incontinence urinaire. Or, même si cela est parfois expliqué par le chirurgien avant l’intervention, c’est une chose de dire « vous avez un risque de fuite urinaire » et une autre de vivre avec une incontinence urinaire et de se rendre compte de ce que c’est. Il n’y a que quand on l’a ressenti, expérimenté, que l’on est en permanence mouillé, en permanence dans des protections, que l’on peut se rendre compte de ce que représente ce handicap. L’incontinence urinaire est bien un handicap et non un sujet d’inconfort.
Récupération
La rééducation pelvi-périnéale est incontournable dans le postopératoire immédiat . Elle est même idéalement débutée avant l’intervention chirurgicale pour que le malade puisse, immédiatement, après l’intervention, débuter son auto-rééducation.
en savoir plus sur la rééducation périnéale
L’essentiel des malades récupérera spontanément, parce que l’inflammation et la fibrose (durcissement des tissus et perte d’élasticité) peuvent s’améliorer avec le temps. Ce sont les six premiers mois qui sont importants. En revanche le taux de récupération de six mois à un an est infime.
Taux résiduel d’incontinence
Il peut être estimé, aujourd’hui, au-delà d’un an, à environ 20 à 25% quand on regarde les études bien conduites sur le risque d’incontinence urinaire. Cela ne veut pas dire qu’un quart des malades aura une incontinence urinaire totale, mais cela signifie que 20 à 25% des patients auront des fuites d’urine à des degrés variables.
Le risque d’incontinence urinaire totale, qui est souvent celui qui est donné (dès que je me lève, cela se met à couler) est de l’ordre de 3 à 5%. Ce risque a finalement peu varié au cours de ces dernières années, malgré la modification des techniques chirurgicales.
Les troubles de la continence après radiothérapie
Après radiothérapie, certains patients sont confrontés à des fuites dues à des contractions non contrôlées de la vessie. Ce problème peut être amélioré avec la prescription de médicaments de type anticholinergique. Le patient peut aussi secondairement être confronté à des fuites provoquées par une insuffisance sphinctérienne. Celle-ci étant déclenchée par l’atteinte des nerfs et de la vascularisation des muscles des sphincters urinaires.
Après radiothérapie, le taux de succès du sphincter artificiel en cas d’incontinence sévère, est moindre qu’après prostatectomie.
source : Dans la tourmente de la prostate
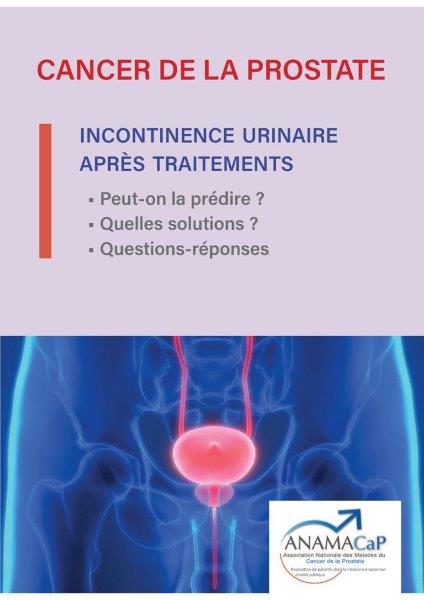
Mise en ligne : janvier 2025

